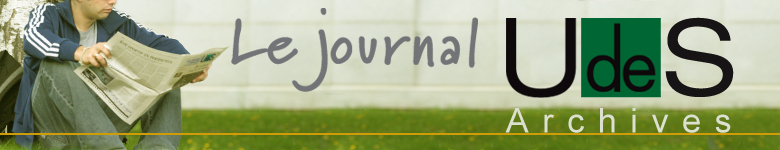 Numéro archivé : 22 mai 2008 (no 5)
Numéro archivé : 22 mai 2008 (no 5)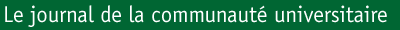
 |
| Bernard Langlois |
| Photo : Michel Caron |
22 mai 2008
Karine Bellerive
Reconnu pour sa grande humanité et pour son engagement exemplaire, le chef technique du Centre culturel de l'Université, Bernard Langlois, est doté d'un sens artistique naturel et d'une conscience environnementale exceptionnelle. Son leitmotiv : aller plus loin, tout simplement.
Le cheminement professionnel de ce talentueux concepteur d'environnements scéniques et d'éclairages est décidément atypique. Spécialiste des décors et de la lumière, il n'a pourtant pas acquis ses connaissances en scénographie sur les bancs d'école. «Je suis un autodidacte», avoue-t-il d'emblée. Par contre, c'est bien dans un cadre scolaire que s'est révélée sa passion pour le théâtre. Fasciné par la mécanique de la scène, il s'est impliqué au sein du comité culturel de son école secondaire et il a participé à plusieurs projets tout au long de ses études collégiales au Séminaire de Sherbrooke. «J'étais vraiment un mordu!» s'exclame Bernard Langlois.
La vie prenant parfois quelques détours, il s'est ensuite déniché un emploi de dessinateur dans un bureau d'ingénieurs. «Je dessinais des tuyaux de plomberie», relate-t-il, sourire en coin. Loin de renier cette expérience, il affirme que le dessin technique lui a donné de bons outils pour son travail d'homme de scène. «Ça m'a permis de comprendre toute l'importance de l'aspect ingénierie dans ce métier, explique-t-il. Pour arriver à projeter l'émotion, il faut avoir une vision pratique. On doit faire appel à l'invention. On doit se demander comment utiliser et réutiliser les objets. En bout de ligne, les accessoires et les éclairages sont au service de l'émotion.»
Le scénographe se réclame ainsi du «théâtre pauvre» théorisé par le metteur en scène polonais Jerzy Grotowski. Considéré comme l'un des plus grands réformateurs du théâtre du 20e siècle, ce dernier délaissait les décors et les éclairages jugés superflus au profit du jeu de l'acteur et de sa relation avec le spectateur. «Je viens de cette école, souligne Bernard Langlois. Je privilégie les lignes épurées. Je veux que tout soit le plus simple, mais le plus parlant possible. L'attention doit être portée sur l'être.»
Son approche minimaliste semble plaire puisque de nombreuses organisations culturelles, dont le Théâtre de la poursuite, le Théâtre du sang neuf, le Théâtre du double signe et la compagnie de danse Sursaut ont sollicité ses services au cours des 25 dernières années. «J'ai été directeur de production pour à peu près toutes les compagnies de la région», rigole-t-il.
 |
| La salle Maurice-O'Bready |
Embauché par le Centre culturel de l'UdeS en 1990, Bernard Langlois contribue depuis ce temps à faire de la salle Maurice-O'Bready un lieu de diffusion incontournable dans la région. «C'est un magnifique outil culturel, affirme-t-il avec fierté. La salle est imposante, équipée, et elle bénéficie de ressources humaines qualifiées. C'est fou ce que ça nous permet de faire. La programmation de spectacles est impressionnante! Et on ne parle même pas des congrès...»
Un de ses plus récents défis a été de participer à la réinvention du cérémonial de la collation des grades, en 2006. Selon lui, il s'agissait essentiellement de bien cerner l'atmosphère qu'il fallait insuffler à l'événement pour enflammer le sentiment d'appartenance des diplômés, reconnaître leurs efforts et donner un sens à ces années qui les ont vu se construire : «C'est une grande réussite, affirme Bernard Langlois. L'ambiance était extraordinaire. On sentait l'énergie des étudiants. On espérait que cela fonctionne, mais on a nous-mêmes été surpris de voir l'ampleur de l'émotion.» Le concepteur travaille actuellement à la préparation de la 3e édition de ce nouveau rituel universitaire.
Chef technique depuis environ deux ans, ses nouvelles fonctions l'éloignent toutefois en grande partie de l'aspect créatif de son métier. Il passe beaucoup de temps à gérer l'organisation des événements, l'entretien, les inventaires ainsi que l'achat de matériel et d'équipements. Mais il ne s'en plaint pas. «Ce système fait en sorte que les informations circulent mieux, dit-il. Nous sommes plus efficaces.» Depuis qu'il est en poste, un rattrapage a également été effectué au niveau de la formation professionnelle. «Il faut aller voir ailleurs pour s'inspirer, voir d'autres façons de faire, connaître les nouvelles technologies, clame-t-il. Ça nous permet d'ajouter des cordes à notre arc, de voir comment on peut aller plus loin.»
 |
| Bernard Langlois |
| Photo : Michel Caron |
C'est donc pour aller encore plus loin que Bernard Langlois a lui-même assisté à une formation du projet Éco-scène, une organisation qui fait la promotion de méthodes et de technologies respectueuses de l'environnement dans le milieu québécois des arts de la scène. Son objectif : faire de la salle Maurice-O'Bready la salle de spectacle la plus verte en région. «On peut faire beaucoup au niveau de la consommation d'énergie, affirme-t-il. On peut aussi trouver des voies de récupération pour les matériaux. Comme on est dans une université, on peut développer des stratégies avec les gens des autres départements, comme en génie, par exemple. Quand on commence ça, les ramifications se multiplient.»
Ainsi, le chef technique privilégie la collaboration. «Je crois en la notion de leadership, dit-il. Mais je ne crois pas en l'idée d'être tout seul à la tête d'une organisation ou d'une équipe de travail. Le leadership, c'est aider les autres à exploiter au maximum leurs compétences et leurs capacités. Pour cela, il faut se soucier des besoins et des valeurs de chacun.» Bernard Langlois entretient donc une vision globale de la vie, qui préconise l'harmonie entre les individus, de même qu'entre les humains et la planète. «J'essaie de toujours avoir un double regard, conclut-il philosophiquement. Je me pose continuellement ces questions : Est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement? Est-ce que ce serait mieux pour l'environnement, est-ce que ce serait mieux pour les gens? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus?»
22 mai 2008 (no 5)
10 étudiantes de l'UdeS au tableau d'honneur
Le Centre universitaire de formation en environnement en lice pour un prix Phénix
Paul Grand'Maison reçoit le Prix de l'éducateur médical de l'année
Hommage à deux infirmières remarquables
2 juillet 2009 (no 20)
Un bâtiment expérimental unique au Canada
Découverte fondamentale sur les cancers hormono-dépendants
Pour optimiser la formation des médecins et des professionnels de la santé
Sherbrooke remporte deux prix prestigieux
Garçons et filles ont des comportements très différents en arts plastiques
Comment Internet a changé la vie des voyageurs
Qu'est-ce que l'intelligence d'affaires?
Une nouvelle formation pour les professionnels de la santé à Longueuil
Une préservation linguistique très différente
Ahmed El-Sayed et Brahim Benmokrane honorés
L'UdeS signe une entente avec l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier
L'Université diplôme 113 nouveaux médecins
Vers un réseau de la formation continue à l'UdeS
Hélène Payette reprend officiellement la direction